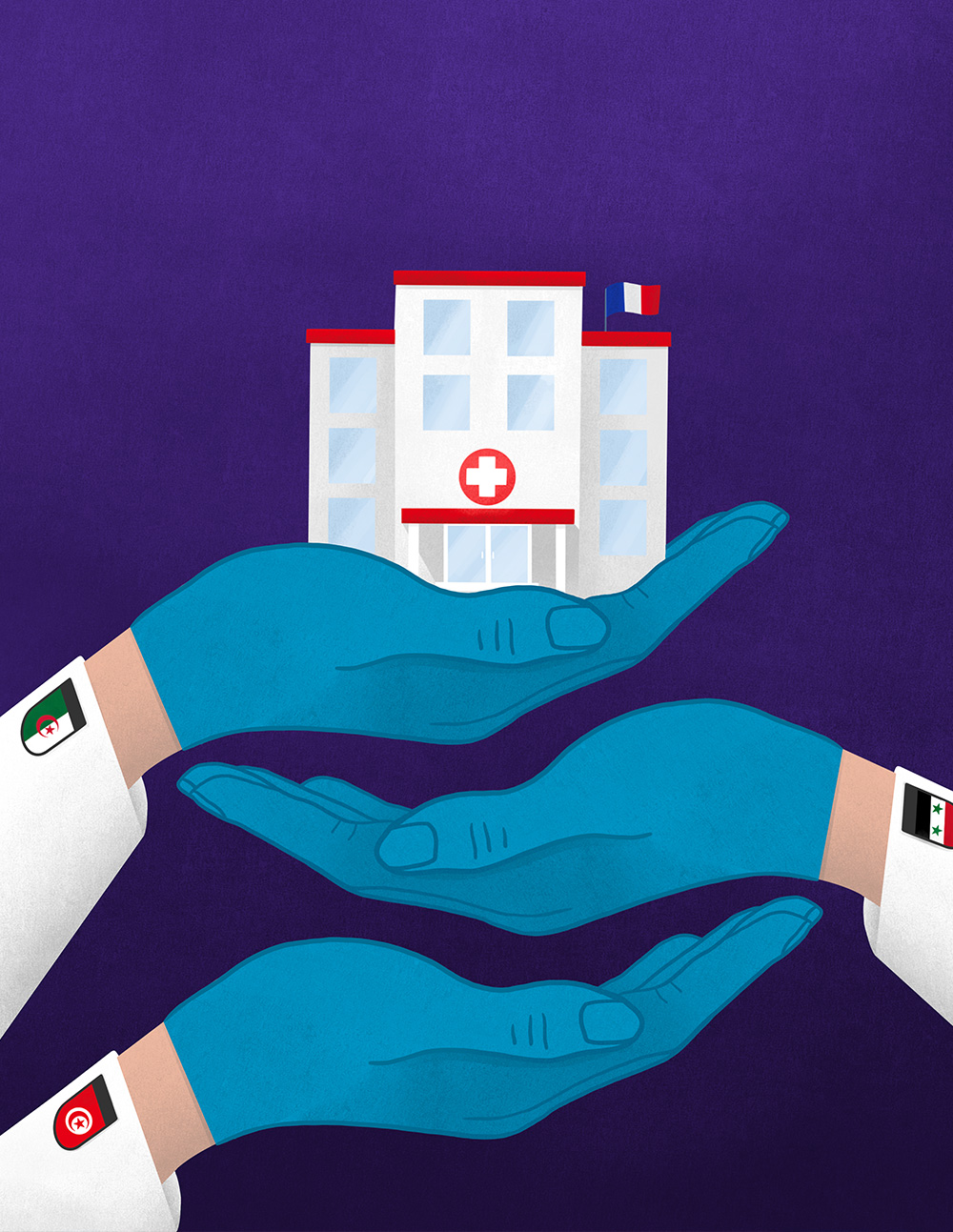50 ans de féminisme
Partie 3 : Réclamer ses droits
À l’approche du 8 mars, journée de lutte pour les droits des femmes, Margaux Mazellier raconte la remobilisation pour dépasser les scissions.
Transcription
Notre ville féministe imaginaire commence enfin à se dessiner. Les femmes peuvent donc se déplacer mais aussi flâner et se divertir librement. Ensemble, plus fortes, elles peuvent maintenant réclamer leurs droits sans crainte. Car manifester c’est aussi concrétiser son appartenance à la ville. C’est s’indigner ensemble, physiquement et en nombre, contre les violences sexistes. Quel meilleur endroit que la rue pour le faire ?
Nous sommes le 8 mars 2023. Plusieurs dizaines de stands sont installés sous l’ombrière du Vieux-Port : c’est la Zone d’occupation féministe, organisée par le collectif Marseille 8 mars à l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. De nombreuses associations locales sont présentes. Au niveau de la bouche de métro, à côté d’un espace garderie, un grand groupe prépare des pancartes pour la manifestation qui partira à 17 h 30. L’après-midi se déroule dans un mélange d’excitation et de joie (voir vidéo).
Dépasser les scissions
Depuis 2018, Marseille 8 mars, et avant lui le collectif Marseille féministe, mènent un travail de remobilisation autour du 8 mars et du 25 novembre. Un travail qui semble avoir payé puisque chaque année, les manifestant.es se font plus nombreux.ses. Environ 500 le 25 novembre 2019, elles seront 3 500 le 8 mars 2020. Un chiffre qui ne décroît pas depuis.
Une remobilisation dont les débuts ont pourtant été difficiles à Marseille. En 2019, après l’appel national du collectif #NousToutes, près de 150 000 personnes avaient défilé dans les rues de toute la France. On parlait alors de déferlante violette, la couleur de cette cause. L’une des plus grosses manifestations féministes depuis longtemps. À Marseille, elle réunit à peine 500 personnes contre 8 000 à Lyon par exemple. En cause notamment : une scission intergénérationnelle. Les associations historiquement organisatrices et le récent collectif Marseille féministe peinent à s’entendre. Parmi les principaux sujets de dissensions : la défense des travailleur·euses du sexe, la lutte contre la transphobie et l’islamophobie. Depuis cette année-là, la manifestation est scindée en deux.
Quelques années plus tôt, en 2005, le collectif Féministes Pour l’Égalité publiait un communiqué déplorant déjà l’exclusion par certaines militantes féministes des femmes portant un voile lors de la Marche mondiale des femmes de 2005. Dans ce texte, elles racontent comment certaines manifestantes ont tenté d’empêcher certaines d’entre elles de monter dans le train, au prétexte de leur foulard. Pendant le trajet puis dans la manifestation, les humiliations ont continué.
Sans entrer dans les détails des guerres intestines au sein des luttes féministes à Marseille, cette rupture intergénérationnelle est importante mais s’observe aussi au niveau national. Elle montre surtout que même parmi les femmes, toutes ne sont pas tolérées de la même façon dans la rue. Si le genre est le dénominateur de bien des violences dans l’espace public, il ne faut pas oublier que d’autres marqueurs sociaux déterminent la violence que peuvent y rencontrer certaines femmes. Certaines ont plus peur que d’autres.
Pour vous donner une idée, voici quelques chiffres. 85% des personnes transgenre ont déjà subi un acte transphobe, près de 80 % des femmes en situation de handicap sont victimes de violences, 75% des agressions islamophobes le sont contre des femmes.
Un combat intersectionnel
Découvrons maintenant un extrait du documentaire « La nuit, je marche » réalisé par Christine Gabory, Ivora Cusack et Agathe Dreyfus, tourné la nuit du 7 au 8 mars 2015 lors d’une marche de nuit en non-mixité. Dans cette vidéo, les militant.es marseillaises revendiquaient déjà un féminisme plus inclusif.
Cette perspective intersectionnelle, c’est-à-dire le fait de considérer que les différentes formes d’oppression s’articulent et se renforcent mutuellement, s’est démocratisée dans les années post #Metoo mais existe depuis longtemps à Marseille. Elle rend la rue à toutes les femmes qui en étaient exclues jusque-là et permet diverses représentations de femmes fortes dans l’espace public.
Pour évoquer cette question, une jeune féministe de 17 ans, Myriam Loussif, monte sur scène. Elle est notamment l’autrice d’un recueil de textes intitulé « Les défaillances du cœur ». Un ouvrage qui évoque « la vie d’une jeune adolescente banlieusarde ». Un extrait de ce texte décrit comment les discriminations s’ajoutent les unes aux autres.
« Je suis celle qui durant ma scolarité a été le sujet favori des médias. Une année pour la longueur de mes vêtements. Une autre pour ce que je place sur ma tête. Je suis celle qu’on a privée de parole beaucoup trop longtemps. Je suis la personne qui ne doit pas développer son torse, s’il est développé. Je suis celle qu’on sexualise quand je porte des lunettes, ou alors quand j’ai une sucette à la bouche. Je suis celle à qui on dit de se couvrir quand je nourris mon enfant. Je suis celle à qui on demande de quitter le bus pour son voile. Celle que l’on accuse d’être provocatrice quand je porte une jupe (…) », lit-elle sur scène.
Dans ses textes, Myriam Loussif raconte le harcèlement de rue ou les commentaires sur le port du voile qu’elle subit. « À l’école, on n’est pas forcément acceptée, témoigne-t-elle. À chaque fois, on me ramenait à ça ». Elle découvre des réunions anti-islamophobie au centre La Dar. « Je me suis dit “on est quelque part“. Que ce soit les féministes que je suis sur insta ou dans les manifs, je ne voyais pas de femmes qui portaient le voile. Ça m’a rassurée de savoir que je pouvais parler sans être ramenée à « radicale » ou « complotiste », explique-t-elle.
Dans notre ville féministe imaginaire rêvée, les rues sont accueillantes pour toutes et tous. Une ville dans laquelle nos corps ne posent plus problème. Où ils ne sont plus considérés comme trop sexués, trop couverts, pas assez, trop foncés, trop vulnérables, trop puissants. Une ville dans laquelle nous n’avons plus besoin de hurler pour être entendues. Cette ville n’existe malheureusement pas encore. Mais parce qu’il y a des personnes comme celles que vous avez rencontrées ce soir, cet imaginaire devient peu à peu une réalité.
Une enquête sur scène de Margaux Mazellier